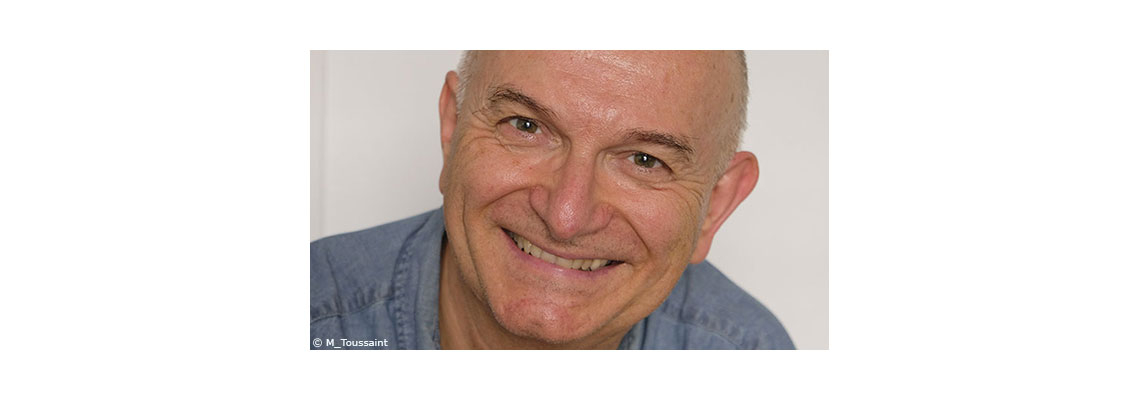Voilà donc les philosophes qui s’intéressent aux microbiotes, ces milliards de bactéries, virus et champignons qui peuplent notre intestin, notre peau, notre bouche, notre sexe… Et c’est tant mieux ! Parce que la découverte au début des années 2000 de l’importance du microbiote intestinal (et de bien d’autres depuis), génère des enseignements au-delà du monde scientifique, tant elle bouleverse nos conceptions sur le plan médical, philosophique voire politique.
On a appris ainsi, par exemple, que l’excès d’hygiène pouvait être néfaste, l’absence de bonnes bactéries pouvant être corrélée à des pathologies graves, physiques ou psychiques (voir : L’intestin : un rôle stratégique dans notre santé, Microbiote intestinal : une révolution pour la médecine ? et Microbiote intestinal et santé mentale)…
On a appris également que nous avons tous une composition singulière de notre microbiote intestinal et que celui-ci influe sur nos envies alimentaires, notre humeur et même sur l’efficacité de certains médicaments.
Il y aurait un inconscient microbien : le microbiote influence nos états physiques et mentaux voire notre vision du monde.
Formé à la fois par ce que nous ont transmis nos parents (surtout notre mère notamment au moment de la naissance) et par tout ce à quoi nous avons été confrontés en terme d’alimentation, il est bien-sûr le résultat de notre culture mais aussi, à l’âge adulte, celui de nos choix volontaires.
“Une forme de singularité par les tripes,” affirme dans son livre, Fermentations (éditions Seuil), Anne-Sophie Moreau, philosophe et journaliste.
Le fait que nous hébergions un nombre de micro-organismes supérieur à celui des nos globules blancs pose des questions vertigineuses sur l’identité humaine. Nous sommes singuliers mais aussi pluriels car nous sommes une symbiose entre différentes espèces. Cela nous relie au monde et montre que l’ancienne conception de l’être humain, séparé de la nature, n’a plus aucun sens au vu des dernières découvertes scientifiques.
Kombucha, kéfir, pain au levain, compost… La mode est à la fermentation (voir : Aliments fermentés : du vivant dans l'assiette !). Nous sortons, selon Anne-Sophie Moreau, de l’écologie du mignon (bébé phoque, nounours blanc, panda…) pour développer une empathie vers des formes du vivant qui n’ont pas de visage et nous semblaient repoussantes autrefois !
Que dit cette fascination pour les micro-organismes ? Cet intérêt est-il le signe d’une pourriture, d’une décadence de la société ou celui d’un bouillonnement, d’une fermentation permettant la régénération de nos entrailles, de nos corps mais aussi de la civilisation ?
Cette idée de régénération par la transformation du vivant évoque les notions bouddhiste et taoïste de changement permanent, s’inscrivant dans un cycle de disparition et de renaissance. Elle nous sort de la linéarité qui caractérise la pensée occidentale.
Anne-Sophie Moreau suggère aussi qu’elle pourrait inspirer les écologistes et venir avantageusement remplacer la décroissance, souvent agitée comme un chiffon rouge et qui évoque plutôt une idée négative de déclin. La décroissance ne peut guère enthousiasmer. La “transformation régénérative” ou “la régénération économique” pourrait-elle rallier plus de suffrages ?
Restons dans le politique : les microbiotes nous enseignent surtout que, à l’image de l’organisme humain, le corps social ne peut, pour rester en bonne santé, que s’ouvrir à l’altérité et s’éloigner de la crispation identitaire.